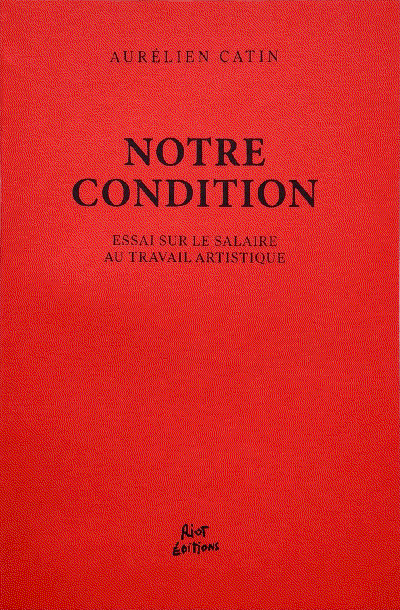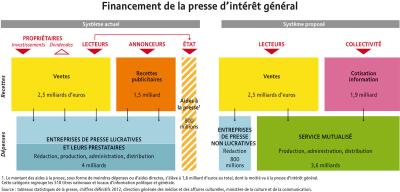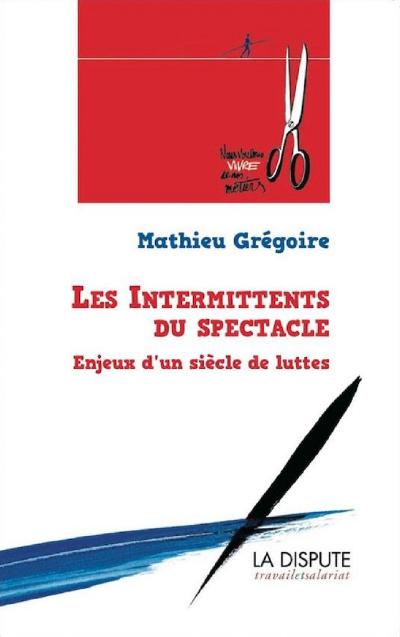« Le modèle des intermittents, c’est une sortie du chômage de masse »

Mathieu Grégoire est maître de conférences à l’Université de Picardie. Il est co-auteur avec Olivier Pilmis du rapport « Quelle indemnisation chômage pour les intermittents du spectacle ? Modélisation et évaluation d’un régime alternatif », commandé par le Syndéac, le syndicat des entreprises artistiques et culturelles, et auteur de Les Intermittents du spectacle – Enjeux d’un siècle de luttes, publié aux éditions La Dispute.
Est-il inexact de dire que le système des intermittents est « à bout de souffle », comme l’a affirmé Manuel Valls lundi matin ?
Ce qui est surtout à bout de souffle, c’est le paritarisme. Il y a un vrai déni de démocratie dans ces négociations entre syndicats et patronat. Certes, l’accord du 22 mars sur l’assurance-chômage est majoritaire. Mais un deal majoritaire ne suffit pas à fonder une légitimité démocratique. Sans revenir sur l’affaire des enveloppes de M. Gautier-Sauvagnac (l’ancien dirigeant de la puissante Union des industries et des métiers de la métallurgie (UIMM), a été condamné en février dernier à trois ans de prison, dont deux avec sursis dans l’affaire de la « caisse noire » de la fédération patronale), dont il faut rappeler qu’il est l’homme qui avait signé l’accord sur l’intermittence de 2003, on voit bien que le Medef a encore une culture démocratique balbutiante.
Formellement, il y a bien un accord majoritaire. Mais est-il démocratique, avant de réformer, de ne consulter personne surtout pas les premiers concernés ? Est-il démocratique de totalement ignorer l’immense travail des parlementaires qui ont réfléchi pendant deux ans aux contours d’une réforme et ont, eux, auditionné des centaines de personnes ? Est-il démocratique de prendre des décisions pour des millions de Français et de refuser de venir s’en expliquer dans les médias ? Est-il démocratique de considérer qu’un gouvernement élu n’a pas son mot à dire dès lors qu’un accord a été trouvé entre le Medef et ses partenaires ? Est-il démocratique que le rapport de la Cour des comptes sur les intermittents soit supervisé par Michel de Virville, qui a présidé l’Unedic comme représentant du Medef ?
Ce système paritaire est donc à revoir. Le paritarisme n’a pas toujours existé et les salariés n’ont pas nécessairement besoin du Medef pour gérer leurs caisses d’assurances sociales. De 1945 à 1967, les caisses de sécurité sociale étaient gérées par des administrateurs salariés sans que le patronat n’ait son mot à dire. De ce point de vue, la menace du Medef de quitter la gestion de l’Unedic si l’accord n’est pas agréé n’est que du bluff, car il n’a rien à y gagner.
Même si on estime le « coût » de l’indemnisation des intermittents à 320 millions d’euros, il est limité si on le compare aux 20 milliards d’euros promis aux entreprises à travers le CICE (Crédit impôts compétitivité emploi). Pourquoi le gouvernement ne réussit-il pas à faire céder le patronat sur les intermittents alors qu’il le choie par ailleurs ?
Je conteste ce chiffre de 320 millions. Il est fondé sur l’idée que si on basculait le régime des intermittents sur le régime général, cela « coûterait » 320 millions d’euros. Mais c’est une aberration comptable de comparer ainsi un régime adapté à l’emploi stable et un autre adapté à l’emploi instable. La ligne de défense du gouvernement a été de dire, en gros : « Les intermittents ont des privilèges, mais pas tant que ça. » En réalité, si on compare ce qui est comparable, les intermittents ne sont pas des privilégiés. Ils représentent 3,5 % des dépenses de l’Unedic et 3,4 % des allocataires. Ils bénéficient d’un calcul spécifique adapté à leur mode de travail, mais pas d’avantages particuliers.
Le Medef s’est engouffré dans cette brèche, parce qu’il s’agit pour lui d’un combat idéologique et qu’il a engagé un rapport de force sur le principe même de la « refondation sociale ». Depuis 2002, le Medef, accompagné par la CFDT, a théorisé l’idée d’un pouvoir absolu du paritarisme, dans lequel le pouvoir politique n’a plus son mot à dire et doit se contenter d’agréer. Ce combat est né du traumatisme, pour le patronat, qu’ont été les 35 heures et le refus par Martine Aubry d’agréer l’accord sur l’assurance-chômage en juillet 2000. Les intermittents se trouvent au cœur de cette lutte pour une refondation sociale qui ne laisserait plus voix au gouvernement ni au parlement. Le Medef frappe un symbole beaucoup plus qu’il ne veut faire des économies, d’autant que des propositions d’économies pensées par les intermittents étaient sur la table.
Le symbole sur lequel il faut frapper est-il lié au fait que les annexes 8 et 10 de l’assurance-chômage font partie des rares dispositifs de protection sociale pensés pour l’emploi discontinu ? Or, aujourd’hui, plus de 80 % des embauches se font en CDD et il y a des millions de salariés pauvres ou à temps partiel. Le raidissement du Medef sur cette question des intermittents s’explique-t-il alors par la volonté d’empêcher les précaires en général de réclamer des droits sociaux en échange de la flexibilité exigée des employés ?
Je ne sais pas si on peut ainsi expliquer le raidissement du Medef, mais ce qui se révèle là est son archaïsme. Le Medef refuse d’aller vers la construction d’un modèle alternatif au plein-emploi qui serait une flexi-sécurité progressiste. Cette croyance au plein-emploi enferme aussi toute une partie de la gauche et de la gauche de la gauche. À chaque élection, on parle de faire baisser le chômage, chacun avec ses « solutions », en promettant sans y croire un plein-emploi auquel plus aucun électeur ne croit.
Ce qui se joue avec le modèle des intermittents, c’est la possibilité d’une autre sortie du chômage de masse et de la précarité pour tous, grâce à la construction d’un deuxième pilier de la protection sociale qui fabriquerait des droits pour les salariés à l’emploi discontinu.
En 1945, on a construit un premier pilier adapté à l’emploi stable. Il ne faut pas le supprimer, mais construire un deuxième pilier pour l’emploi discontinu qui constitue une réalité sociale sur laquelle on ne peut plus cesser de s’aveugler. De 1996 à aujourd’hui, les chômeurs de catégorie A sont passés de 3 millions à 3,3 millions. Dans le même temps, les chômeurs de catégorie B et C, qui cumulent périodes d’emploi et de chômage, sont passés de 500 000 à 1,7 million !
C’est donc un sujet aux enjeux énormes que les intermittents abordent et révèlent : la constitution de droits pour les salariés à emploi discontinu, c’est-à-dire des droits qui déconnectent le salaire de l’emploi et assurent une continuité des ressources malgré une discontinuité de l’emploi. Il n’y a pas d’autres solutions si on veut cesser de promettre aux millions de salariés au chômage ou dans la précarité un CDI pour tous.
En quoi le régime des intermittents peut-il être le modèle d’un rapport au travail et à l’emploi de plus en plus discontinu ?
C’est une esquisse de modèle, parce qu’il reste beaucoup d’imperfections. Mais ce modèle correspond à une version progressiste et de gauche de la flexi-sécurité, où l’on parle de socialisation des salaires. La flexi-sécurité version sociale-libérale ne parle que de formation, sur le mode : « On va vous armer pour que vous soyez des bons petits soldats aptes à affronter le marché du travail et que vous deveniez des chercheurs d’emplois performants dans un monde où le travail se raréfie et où le maître mot est l’employabilité. »
La version progressiste propose que, même si l’emploi est discontinu, le salaire demeure continu. Mais pour ça, il faut socialiser et mettre en commun, ce qui constitue une barrière idéologique forte pour les leaders politiques et patronaux. Cela a pourtant déjà été expérimenté. Il s’agit en fait d’appliquer les mêmes droits, mais avec des techniques différentes, et non pas de donner des droits privilégiés à certains.
Par exemple, en 1936, quand il a fallu donner deux semaines de congés aux gens du spectacle comme aux autres, on ne savait pas comment faire, parce que ces personnes avaient déjà plusieurs employeurs et que l’idée était de faire payer les employeurs. C’est pour cela qu’a été créée la caisse des congés spectacles, où tous les employeurs cotisent, et qui redistribue ensuite l’argent. C’est le même droit que le droit général, en l’occurrence les congés payés, mais avec une procédure différente.
Il faudrait donc étendre ces techniques de mise en commun des sommes versées par les employeurs afin qu’ils bénéficient de manière plus démocratique à l’ensemble des salariés. Mais à partir du moment où une partie de cet argent est socialisée, le patronat considère qu’il s’agit d’une taxe inique. L’autre avantage de ce système est de permettre de conserver le rapport salarial fait de négociation et de conflit entre salariés et patronat, alors que l’idée d’un revenu garanti par l’État finirait pas opposer « assistés » et « contribuables », en escamotant le rapport de force entre employeurs et employés.
Les précaires doivent-ils tous devenir des intermittents?
Tous les salariés dans l’emploi discontinu ou partiel doivent avoir le droit à une forme de socialisation de leurs revenus, qui permette de déconnecter, au moins en partie, le temps de travail et le revenu. C’est vrai pour les intermittents du spectacle comme pour la caissière avec un emploi du temps en forme de gruyère. Cette déconnexion n’est, encore une fois, pas une vue de l’esprit. C’est une tendance qui a émergé en 1979 avec la mensualisation des ouvriers. À partir de là, le salaire mensuel était le même, que le mois fasse 28 ou 31 jours, tandis qu’auparavant les ouvriers étaient payés de manière journalière.
Il est donc nécessaire de socialiser davantage, c’est-à-dire de déplacer une partie de la masse salariale versée en salaire direct en salaire indirect, et donc d’augmenter pour cela les cotisations sociales. Depuis 1945, on a construit des centaines d’hôpitaux, soigné des milliers de malades et versé des dizaines de milliers de retraites avec un système socialisé !
La question est de faire un pas de plus en cessant de penser que ce qui est socialisé n’est pas viable. Je ne dis pas qu’il faut qu’on devienne tous intermittents, mais il faut un deuxième pilier car on ne peut plus se contenter d’un système de protection sociale adapté seulement à l’emploi permanent. D’autant que si les précaires avaient plus de droits, ceux qui se trouvent en emploi stable seraient eux-mêmes plus forts.
Comment faire un modèle d’un régime d’indemnisation qui assure certes une continuité de revenu face à la discontinuité de l’emploi mais qui est déficitaire ?
Le modèle des intermittents n’est pas déficitaire. Il faut arrêter avec ça. Dans « régime des intermittents », il ne faut pas entendre « caisse des intermittents ». C’est à entendre comme dans « régime alimentaire », au sens où il existe des règles spécifiques selon les individus. Il existe une seule caisse, celle de l’assurance-chômage. La définition même d’une assurance, c’est qu’il y a toujours un équilibre entre des petits et des gros excédents et des petits et gros déficits.
On a, d’un côté, des salariés qui ne connaissent pas un seul épisode de chômage dans l’année et génèrent par conséquent un excédent puisqu’ils cotisent sans percevoir d’allocation. Une bonne gestion de l’assurance-chômage, visant l’équilibre des comptes, impliquerait que l’on ait, de l’autre côté, un solde négatif parfaitement symétrique. Les intermittents, comme les intérimaires et tous les autres salariés à l’emploi discontinu, qui connaissent par définition des épisodes de chômage, sont de cet autre côté. Ils pourront donc, aussi longtemps qu’il existera une assurance-chômage et une solidarité interprofessionnelle, être stigmatisés pour leur prétendu déficit.
Par ailleurs, les propositions des intermittents contiennent des propositions pour faire des économies, comme sur le plafond des indemnisations ou la manière dont est envisagée la période de franchise – ou carence – avant laquelle les indemnités ne sont pas versées. Dans un système « à droit de tirage » comme aujourd’hui, les moins intermittents des intermittents, les vedettes qui sont bien payées, ont certes un délai de carence assez long, mais une fois qu’ils l’ont effectué, ils touchent d’importantes indemnités journalières. Dans le système proposé par les intermittents, ce ne serait plus le cas, et ceux qui gagnent beaucoup ne toucheraient pas d’indemnités.
En échange de ces économies justes d’un point de vue social, ils demandent le retour à la date anniversaire des 507 heures sur 12 mois. Avec Olivier Pilmis, nous avions calculé que cela ferait 3,9 % d’allocataires indemnisés en plus chaque année. C’est une dépense supplémentaire non négligeable, mais ce n’est pas non plus une armée de réserve qui attend sous la barre fatidique des 507 heures en 10 mois pour creuser le déficit ! D’un point de vue politique et social, je pense qu’aujourd’hui, admettre les 507 heures en 12 mois est la seule façon de calmer le mouvement social en cours.
Le plafond de cumul salaire-allocations à 5 475 euros brut par mois et l’élargissement du « différé » d’indemnisation, pendant lequel les intermittents devront attendre pour toucher leurs allocations, sont-ils injustes au point de menacer la tenue des festivals ? Ce durcissement du régime d’indemnisation des intermittents signé le 22 mars dernier ne vise-t-il pas en priorité les moins précaires d’entre eux, puisqu’il s’agit d’un plafonnement qui touchera seulement quelques centaines ou milliers d’intermittents bien payés, et que la carence sera proportionnelle aux revenus, et donc plus longue pour les hauts salaires ?
Il y a dans l’accord signé un nivellement par le bas. Mais les médias et les responsables politiques se trompent effectivement sur les raisons de la colère et les motifs profonds du mécontentement qui ne se réduisent pas à ces points techniques. Certes le différé a été très mal calculé dans l’accord du 22 mars. Mais le principe du différé n’est pas forcément un point d’achoppement. Le plafond du cumul fait aussi partie des sacrifices qu’ils étaient prêts à faire pour financer la réintégration des plus précaires. Mais le patronat n’a pris que les sacrifices sans prendre les compensations.
Le problème va donc bien au-delà de l’accord du 22 mars dernier. Les intermittents ne réclament pas plus d’argent. Ils demandent moins de précarité. 2003 a été un traumatisme. À la précarité de l’emploi s’est alors rajoutée une précarité de l’indemnisation. Avant 2003, on pouvait savoir quand, et si, on allait toucher l’indemnisation chômage ou bien se retrouver au RSA dans quelques mois. Depuis 2003 et la suppression de la date anniversaire de l’entrée dans le dispositif, l’incertitude est totale, et l’ouverture de droits à l’indemnisation est soumise à de nombreux aléas. En 2003, on a donc empiré qualitativement la situation des intermittents, sans faire d’économies. Alors qu’avec la même somme d’argent on pourrait indemniser de manière plus certaine et plus juste, on creuse aujourd’hui le traumatisme de 2003 qui n’a cessé de pourrir, et dont on pouvait attendre des socialistes qu’ils le prennent à bras-le-corps.
Avant cette crise, si le Medef avait accepté un statu quo, cela aurait donc pu passer. Mais aujourd’hui, même si les partenaires sociaux renoncent au plafonnement et à l’allongement du délai de carence, cela ne passera pas. Maintenant qu’on est dans un mouvement social, le statu quo n’est pas plus acceptable : les intermittents veulent une vraie réforme et un nouveau deal.