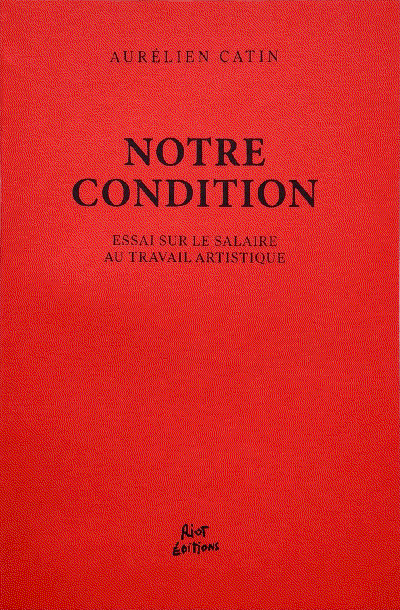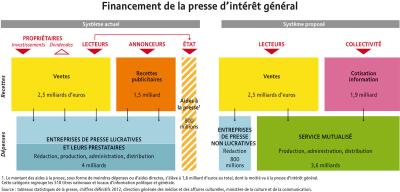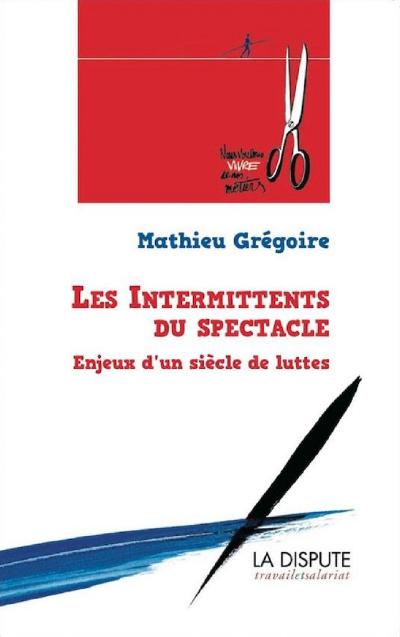Les artistes sont aussi des travailleurs — discussion avec Convergence des Luths (1/2)

« La culture est en danger », entend-on partout. Et, de fait, voici plus d’un an que toute activité artistique en présence de public est arrêtée. Plus d’un an qu’il faut répéter, assurer la maintenance des lieux culturels, annuler festivals et représentations dans l’espoir que ça cesse un jour. Si les salles commencent à rouvrir, n’en demeure pas moins un problème de fond : c’est quoi, la culture ? Ou, plutôt, qui donc la rend possible ? On répondra sans doute : « Les artistes. » La catégorie est commode, englobant tout et son contraire : grands génies solitaires et hors-sol, stars du marché mondial et multitude de précaires et de pauvres romantisés sous couvert de « bohème » et de « chance », celle, tout de même, de pouvoir exercer sa « passion ». Nous nous sommes entretenus avec le jeune collectif de musiciens Convergence des Luths. Pour ces travailleurs de la culture — tel est le titre qu’ils revendiquent —, il est urgent de reconsidérer de fond en comble notre rapport à l’ensemble de ces métiers. Le collectif propose notamment, afin d’abolir le chantage à l’emploi (aux « cachets ») qui hante le quotidien des travailleurs et des travailleuses, l’instauration d’un salaire à la qualification personnelle (plus connu sous le nom de « salaire à vie »). Premier volet.
Vos écrits révèlent combien le monde de la musique classique est traversé par des rapports de classe : chantage à l’emploi, écarts salariaux indécents, organisations hiérarchiques coercitives, etc. N’est-ce pas un « invariant » dans l’histoire de la musique occidentale ?
Sébastien Renaud : L’imaginaire collectif décrit l’artiste comme un être à part — qu’il soit un éternel souffrant, un génie isolé buvant de l’absinthe ou un hippie. Les artistes eux-mêmes peinent à se démarquer de ces images d’Épinal : ils se prennent régulièrement les pieds dans leurs propres caricatures. Nous nous rendons compte qu’une partie du public attend de nous qu’on lui renvoie cette image : quel musicien ne s’entend pas dire après chaque concert « Vous n’exercez pas un métier, vous exercez votre passion, quelle chance ! ». C’est un vieil adage, dont profitent une myriade d’organisateurs véreux : ils sont prêts à vous payer à peine le sandwich et le billet de train en échange du « plaisir d’exercer notre passion ». Ça paraît trop caricatural pour être vrai, et pourtant ! L’artiste isolé, éthéré, planant au-dessus de la vile société des humains, poursuivant sans argent son but de « divertir à tout prix » et de ne surtout pas faire de politique, est une image déjà bien travaillée pendant les études. Elle se perpétue sans discontinuer, jusqu’à être placardée bien en évidence, lors, par exemple, des Victoires de la musique, des interviews de « stars » ou des documentaires — qui ne s’intéressent invariablement qu’aux « grands ». Ces artistes eux-mêmes répètent, un sourire rêveur aux lèvres : « Je n’ai pas l’impression de travailler, j’ai tellement de chance. » Comment voudrions-nous, dans ces conditions, nous fédérer autour d’une idée politique ? L’artiste de l’inconscient collectif nous l’interdit… L’institution capitaliste se gardera bien d’écorner cette image. L’individu atomisé est un bon consommateur silencieux : l’artiste seul dans sa chambre de bonne, qui gribouille des poèmes pour rien ou peint des toiles qui ne valent rien tant qu’il n’est pas mort est un très bon capitaliste, en fin de compte. C’est l’image — complètement fausse — de l’artiste du XIXe. Elle continue de nous faire beaucoup de mal.
Concrètement : que vient changer cette institution capitaliste de la société dans la production musicale ?
Rémy Cardinale : Que les choses soient dites une fois pour toutes : la pleine puissance du capitalisme à la fin du XVIIIe siècle fut un immense progrès social. « L’individu libre sur un marché », comme l’a très bien décrit Marx, a changé la pratique du travail. On peut clairement parler ici d’un véritable changement anthropologique. Prenons l’exemple du musicien d’avant la Révolution française. Pour gagner sa vie, il devait être le sujet de la noblesse. La seule chance d’exercer son art était donc de signer un contrat avec une cour possédant une chapelle de musique. L’exemple d’Haydn est bien connu : dès l’âge de 29 ans, il a été au service des princes Esterházy en Hongrie, avec quelques aménagements à la fin de sa vie. L’autre exemple que je donne souvent est celui de Mozart. Il exprime parfaitement le changement de mode de production. Mozart est avec son père au service du prince-archevêque Colloredo, à Salzbourg. Cette condition de valet lui est insupportable — ce qui prouve que les idées des Lumières ont fini par infuser dans la sphère même de l’aristocratie. Il réussit à partir de cette prison dorée et arrive à Vienne en 1781 en compositeur indépendant, en « individu libre sur un marché », donc. Cette nouvelle liberté n’est pas sans risque car, dorénavant, il va falloir se vendre, et vivre de la validation sociale du produit de son travail. Et ça n’est pas non plus une partie de plaisir. La violence économique du marché capitaliste est une autre forme d’aliénation. Il faut plaire, se rendre désirable auprès d’un marché toujours en mouvement et changeant1. C’est ce que le jeune Beethoven a compris très tôt quand il est lui aussi arrivé à Vienne en 1792. Tia DeNora, professeure de sociologie, démontre dans son livre Beethoven, la construction du génie comment ce jeune compositeur perçoit les limites du libre marché capitaliste. C’est que la vente de ses œuvres est conditionnée par les désirs des clients.
Et qui sont ces clients ?
Rémy Cardinale : L’aristocratie et la nouvelle bourgeoisie de l’époque, qui aiment se divertir en jouant de la musique. Mais à condition qu’elle soit accessible, c’est-à-dire facile à jouer ! Cette injonction est insupportable pour ce révolutionnaire de la musique. Toute sa vie sera un combat pour obtenir une rente à vie auprès de l’aristocratie viennoise afin de pouvoir composer, donc travailler, en dehors des contraintes matérielles. Je crois que le combat de Beethoven est en passe d’être gagné si nous élargissons la part du salaire socialisé des intermittents à toute la production !
Y a‑t-il une tradition militante, syndicale ou politique au sein de l’histoire de la musique dont vous réclamez l’héritage ?
Rémy Cardinale : Tout le problème est là ! Les musiciens classiques sont culturellement inféodés à la bourgeoisie. Historiquement, ça se comprend. La musique et les arts en général ont toujours été des armes idéologiques pour les classes dominantes. Ils permettaient à peu de frais d’instaurer une hégémonie culturelle faisant rayonner le pouvoir en place dans un large territoire. La bourgeoisie, arrivant au pouvoir à la fin du XVIIIe siècle, a emboîté le pas. Incertaine sur son goût, au début, elle a réussi au fil des années à enrichir sa culture, pour atteindre à la fin du siècle suivant un niveau égal à l’ancienne aristocratie. Le bouleversement social qui a lieu à la fin du XIXe siècle, avec la montée de l’anarchisme, du communisme et des syndicats, a eu un réel retentissement sur les artistes. L’hyper-flexibilité du travail artistique était à son paroxysme au début du XXe siècle, et la réaction corporatiste ne s’est pas fait attendre. De 1919 à 1936, les syndiqués musiciens frôlent les 100 % — de quoi peser sur le rapport de force face aux embaucheurs. La mise à l’index de ces derniers, s’ils ne se conforment pas au tarif syndical, et la mise au pilori des « traîtres » qui ne respectent pas la consigne syndicale sont des armes très efficaces pour garantir le minimum aux artistes dans un marché de la culture complètement libéral. À cette époque, l’État est sur ce plan inexistant. S’ensuivra au milieu du siècle l’avènement de l’emploi et son objectif de plein-emploi avec l’imposition des conventions collectives à ceux qui embauchent. L’État devient enfin un acteur incontournable avec des politiques culturelles, augmentant de fait l’offre d’emploi2. Les syndicats luttent pour que tout le travail artistique se fonde dans l’emploi et que ses conventions collectives soient sans cesse revalorisées. Convergence des Luths est un collectif qui agit à côté des syndicats. Il n’a évidemment pas leur maîtrise technique et ne peut se substituer à leur formidable engagement. Il peut en revanche faire tout un travail éducatif et politique auprès des travailleurs de la culture. L’éducation populaire n’est plus trop à l’agenda syndical par manque de moyens humains. Si nous pouvons prendre le relais, ce sera déjà énorme.
Car les conventions dont vous parlez, malgré les nouveaux droits qu’elles confèrent aux artistes, demeurent pour vous insuffisantes…
Rémy Cardinale : Oui, car à la fin des années 1970, ce combat est loin d’être gagné. Le travail au noir persiste ! Comment résister à l’envie d’exercer son art même si les conditions de travail ne respectent pas les conventions collectives ? C’est là où l’imaginaire bourgeois fait son œuvre. Flattés d’être des artistes, des créateurs, nous avons beaucoup de mal à nous considérer comme des « travailleurs de la culture ». Ce mot écorche la gueule de nombreux d’entre nous. La classe bourgeoise le sait et joue sur la corde sensible de l’exception culturelle. Certes, l’abaissement considérable des conditions d’entrée au régime des intermittents du spectacle, grâce à la convention de 1979 soutenue par la CGT de l’époque, a permis une énorme augmentation de travailleurs indemnisés par l’assurance chômage entre deux emplois. Avant 1979 il fallait faire 1 000 heures par an dans l’emploi ; depuis, il suffit d’en faire 507. Cette réforme a changé notre rapport au travail artistique. Mais malgré ça, les musiciens — et surtout les musiciens classiques — restent peu syndiqués aujourd’hui, et peu sensibles aux enjeux politiques. Comme si ça n’était pas pour nous, comme si nous étions au-dessus de tout ça. Il faut dire que notre répertoire est en général apprécié par la bourgeoisie, majoritaire dans nos salles de concert. Nous nous identifions facilement aux codes de cette classe dominante qui sait encore une fois flatter nos egos. Les crises sanitaire, sociale et économique sont peut-être en train de nous réveiller.
Aujourd’hui, comment sont structurés les syndicats et les musiciens ?
Sébastien Renaud : Il y a bien une tradition militante, mais en ce qui concerne la musique classique, elle est présente sous forme de syndicats au sein des institutions conventionnées : ce qu’on appelle « les grandes maisons », essentiellement les orchestres (Opéras nationaux, Orchestres symphoniques, etc.). Ces syndicats sont directement responsables de l’installation et des conventions de ces institutions et, grâce à un travail de fond effectué sur plusieurs générations, les travailleurs et les travailleuses y sont protégés. Il reste encore du chemin, notamment vers l’idée de l’émancipation et de la propriété des artistes sur leur travail, mais beaucoup a déjà été fait ! En outre, lorsqu’un intermittent du spectacle travaille avec eux, les choses sont encadrées. Cachets, tarifs, contrats de travail, horaires transparents : autant de choses inexistantes, ou presque, dans le cadre des ensembles non-conventionnés, où la tradition syndicale est volontairement atomisée, tuée. Ces ensembles, particulièrement présents dans le milieu de la musique dite « ancienne » (baroque, pour simplifier), existent sous la houlette d’un chef unique, qu’il ou elle soit chef d’orchestre ou claveciniste, ou les deux. Le chef est le directeur musical, directeur artistique… et recruteur. Son pouvoir est total. Il convient ici de ne pas négliger la masse de travail considérable que ça représente, mais d’insister sur la concentration des pouvoirs. Ces ensembles fonctionnent au projet ou, dans le meilleur des cas, à la saison. Les musiciens n’ont que des contrats courts : la seule chose qui les relie au contrat suivant est le bon vouloir du recruteur, et la sonnerie du téléphone portable… Le musicien, le travailleur, n’a absolument aucun levier d’action ou de pression pour revendiquer quoi que ce soit. Il suffit de ne pas le rappeler. Derrière, la manne de jeunes artistes qui disent oui à tout parce qu’ils crèvent de faim est inépuisable, infinie. Si le chef décide qu’il n’y aura pas de pause, qu’on travaillera jusqu’à telle heure et qu’on jouera de telle manière, personne n’osera se lever seul : sa tête tomberait. Dans ces conditions, on comprend bien pourquoi et comment il n’existe pas la moindre fédération politique au sein de ces ensembles. D’autre part, grâce à la libération de la parole au sein de notre collectif, on sait maintenant que certains ou certaines déclarent tout de go devant les artistes, sans complexe, qu’ils ne veulent pas voir la couleur d’un syndicat chez leurs musiciens.
Dans ce contexte, on comprend qu’il est très rare de voir la création d’un collectif de musiciens classiques militants comme le vôtre. Comment l’idée est-elle née ?
Rémy Cardinale : Il a été créé au moment de la mobilisation contre la réforme des retraites, en janvier 2020. En tant que musicien coanimateur de l’ensemble musical L’Armée des Romantiques, dont la couleur politique n’est un secret pour personne, j’ai senti des velléités de la part de certains collègues à prendre part à la mobilisation générale contre la réforme des retraites. Bien sûr il y avait déjà eu la formidable action du corps de ballet de l’Opéra de Paris, suivi par son orchestre. Mais pour l’immense majorité des musiciens classiques, la prise de parole n’était pas simple. Comment faire, comment tenter des actions quand vous êtes dans le chantage à l’emploi permanent ? Avec Sébastien, qui est aussi membre de L’Armée des Romantiques, nous avons imaginé créer un espace de paroles, clos au début, et réservé à tous ceux qui désiraient s’exprimer sur leurs conditions de travail. L’objectif à long terme étant de former les collègues à une véritable culture politique afin de s’armer idéologiquement pour mener la bataille politique face au pouvoir bourgeois, dont l’hégémonie est totale dans le milieu de la musique classique.
Comment avez-vous donc procédé ?
Rémy Cardinale : Nous avons organisé une réunion avec une quinzaine de personnes venant d’horizons divers : musiciens d’orchestre permanents, intermittents du spectacle, professeurs de conservatoires, etc. Les échanges ont été riches mais nous avons rapidement constaté que personne ne savait ce qu’il se passait chez les collègues. Les timides actions n’étaient connues de personne. Les infos ne passaient pas pour une raison très simple : la peur du retour de bâton. Cette omerta généralisée est source d’une grande souffrance chez les musiciens. Nos intuitions se sont donc concrétisées : il était grand temps de former un collectif afin de créer un jour une masse critique. La crise sanitaire est arrivée tout de suite après, stoppant net notre élan. Mais les agissements des frères Capuçon, s’autoproclamant défenseurs de la « culture » afin d’augmenter un peu plus leurs pouvoirs médiatiques, ont été pour nous un déclic pour repartir au combat3. Depuis le début d’année nous avons appris à mieux nous organiser, à nous structurer avec un site Internet sur lequel nous publions le plus souvent possible des textes qui traitent de notre condition d’artiste. Pour l’essentiel, ils se composent de retours d’expériences et de propositions politiques où l’influence de Réseau Salariat n’est pas pure coïncidence. Le volet éducation populaire débute à peine. Nous comptons bien l’étendre le plus rapidement possible.
Sébastien Renaud : Un sujet de poids revenait sur la table des discussions : les artistes du milieu, en particulier les indépendants, ne sont pas fédérés, ne se connaissent pas… et ne se parlent pas. Très peu étaient présents. Très peu savent que certains de leurs pairs sont au RSA presque toute l’année. Ils sont démunis face à des attaques qui sont, elles, bien installées et bien organisées. Convergence des Luths, c’est l’idée d’un chemin long et lent, celui d’une prise de conscience de l’autre et du commun, puis celui de se fédérer pour œuvrer ensemble (et donc se rapprocher des syndicats existants). Ça peut paraître presque désuet… mais concernant la plupart des artistes indépendants, y compris moi-même au début, on partait de zéro.
Dans les conservatoires et les écoles supérieures, la question du travail semble presque absente : comme si, très tôt, on voulait donner l’impression aux jeunes que la musique est gratuite. Pourquoi durant la formation des jeunes musiciens n’apprend-on presque jamais, au-delà des compétences musicales, ce qui fait tout le « métier » du musicien et son inscription dans la société ?
Sébastien Renaud : Les artistes sont intimement convaincus qu’ils sont des mendiants. C’est ce qu’on leur a appris, dès le conservatoire, où on leur dit que si ils sont « plus doués que les autres » ils pourront mendier plus cher. Et s’ils sont « les meilleurs », ils décideront à leur tour qui travaille et qui ne travaille pas, tout en lançant des appels vibrants à « envoyer plus d’argent ». Nous n’arrivons pas, pour l’instant, à nous sortir de cette terrible pyramide. Les « meilleurs » — je suis bien obligé de le dire entre guillemets —, lorsqu’ils sont mis face à un micro, se dépêchent de perpétuer le message. « Nous ne faisons pas de politique, l’art est là pour élever et s’élever », etc. Appels aux dons, connivence avec le pouvoir… Il y a eu un temps où des « grands » étaient faits d’un autre métal, où un Kurt Masur tenait tête à la Stasi, à Leipzig en Allemagne de l’Est, à coups de déclarations et de désobéissances. Ce temps-là est révolu.
Rémy Cardinale : Des institutions comme celles des Conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse (CNSMD) offrent depuis pas mal de temps des cours ou des séminaires afin d’apprendre comment se vendre sur le marché de la musique. Bien entendu, ce n’est pas explicité de la sorte. Mais on apprend comment construire un CV ou un programme afin qu’ils se fondent dans les attentes du marché. Vous me direz que de telles pratiques sont relativement nouvelles, certes, mais la crise chez les musiciens l’est aussi. À mes débuts dans les années 1990, l’idée reçue était de dire qu’un jeune musicien diplômé s’en sortait toujours contrairement aux autres étudiants diplômés. Il ne serait jamais venu à l’esprit d’un étudiant du CNSMD de passer un concours de recrutement dans un orchestre avant d’avoir fini son cursus scolaire. Maintenant c’est devenu chose commune. La crise est totalement consciente chez les étudiants. Alors les institutions les préparent à la violence économique. Mais surtout pas pour leur donner une conscience politique afin de façonner le monde économique à leur propre intérêt de classe. C’est-à-dire penser par exemple à un « salaire à la qualification personnelle » afin de pouvoir créer artistiquement en toute sérénité. C’est encore une fois la force du capitalisme que de nous faire croire à son hégémonie.
Vous évoquez l’exemple des détails « marketing » donnant l’illusion d’un monde musical décontracté et « pop », comme l’envers de l’oppression inhérente aux inégalités que vous dénoncez. Ou, récemment, on pouvait entendre dans la bouche d’un jeune musicien que Vivaldi, pour les gens du XVIIIe siècle, c’est un peu comme du Lady Gaga aujourd’hui. Comment donc se rapprocher du public sans tomber dans ce genre d’absurdités visant à séduire plus qu’à tisser de vrais liens avec les auditeurs ?
Rémy Cardinale : La société du « divertissement » n’a pas épargné le monde de la musique dite « classique ». Et pourquoi l’épargnerait-elle ? Les logiques du marché sont bien présentes aujourd’hui. Les auditeurs ne sont traités que comme des clients. S’il faut qu’ils achètent alors il faut les séduire. Dans ce cas, tout est permis ! Seule une souveraineté totale de notre travail productif, qui s’exprimerait donc par un « salaire à la qualification personnelle » pour tous les travailleurs de la culture, pourrait nous sortir des injonctions du marché capitaliste de l’art. À condition, bien sûr, d’engager parallèlement un travail pédagogique et éducatif sur la maîtrise du travail concret : c’est peut-être la tâche la plus difficile. Sans le soutien de l’école et des institutions pédagogiques, nous serons impuissants.
Sébastien Renaud : C’est tout à fait ça : le stress de la « captation » de l’attention est permanent, obsessionnel, peu importe l’étage de la pyramide auquel on s’est hissé. Les réseaux sociaux ont été, en ce sens, le dernier clou dans le cercueil. L’artiste a intégré qu’il a « cinq secondes » pour capter l’attention, et c’est là qu’il va mettre le paquet : hyper-sexualisation de l’image, débauche d’effets, déclarations calibrées pour les titres, baskets rouges et autres fadaises. L’incapacité de l’artiste à penser son métier — et celui des anciens qu’il interprète — autrement que ce qu’il est aujourd’hui est totale. Ainsi a‑t-on droit aussi à Bach la rockstar, Mozart l’incompris, et ainsi de suite. L’artiste, c’est le Lapin blanc d’Alice : il n’a pas le temps de penser. Il faut aussi comprendre à quel point la course au cachet est une angoisse permanente. Le temps de réflexion disponible à autre chose qu’à se vendre, qu’à cirer des pompes ou répondre à son téléphone portable est si mince, si étriqué, qu’il ne peut réellement être bien utilisé. Ne pas faire assez de cachets, c’est la mort économique, puis sociale. Lorsqu’on cherche à penser le métier autrement, on est taxé de vieux con, de râleur… de syndicaliste. Celui-là dérange, il agace, et il est exclu des carnets d’adresses. Le chantage à l’emploi est aussi simple et aussi cru que ça : je parle d’expérience.
Contre ce que le capitalisme impose aux musiciens, vous défendez le régime d’intermittence non pas comme une « aide » dont « bénéficieraient » passivement les intermittents, mais comme une véritable arme d’émancipation, qui doit même aboutir à terme, on l’a compris, à la disparition des cachets et à un salaire entièrement « socialisé ». Une revendication notamment portée par Bernard Friot…
Rémy Cardinale : Aujourd’hui, les intermittents du spectacle qualifient leur régime de « statut ». Cette erreur sémantique démontre inconsciemment l’aspiration de ces travailleurs de la culture à un véritable statut qui les protégerait des difficultés qu’ils rencontrent chaque année pour boucler leurs heures. Combien d’entre eux sont dans l’angoisse permanente, allant même jusqu’à acheter des cachets à des employeurs s’ils sentent qu’ils peuvent perdre leurs droits en fin d’année ? Cette violence est inadmissible. Elle démontre encore une fois que le mode de production capitaliste refuse qu’un individu soit par essence producteur de valeur économique. Il faut passer par le marché de l’emploi ou le marché des biens et services ! L’enjeu est donc de détacher le salaire de ces deux marchés. D’attribuer à chacun un nouveau droit politique, un droit au salaire à la majorité. À l’image du droit de vote du XIXe siècle, qui n’était alors pas une évidence.
Ce qui est intéressant dans le régime de l’intermittence du spectacle, c’est le chemin déjà parcouru pour détacher le salaire de l’emploi. En effet, en moyenne 50 % du salaire direct vient aujourd’hui de l’emploi (les cachets), les autres 50 % provenant du salaire socialisé. Deux prismes s’offrent à nous. Si nous voyons l’indemnité chômage comme une aide aux artistes entre deux emplois, nous nous enfermons dans la définition capitaliste de la production de la valeur : ne produit de valeur économique que celui qui se plie aux deux marchés précédemment décrits, et le reste s’apparente à de la solidarité interprofessionnelle — allant de ceux qui produisent la valeur vers ceux qui, en raison des aléas de la vie, ne produisent plus. En revanche, si nous lisons l’indemnité chômage comme un « salaire » entre deux emplois, nous donnons une toute autre définition du travail dit « productif ». Je rappelle tout de même que le droit au chômage a été construit comme un « droit au salaire » entre deux emplois. Un salaire certes socialisé, mais bien un salaire qui reconnaît que celui qui le perçoit produit la valeur économique s’exprimant par la monnaie reçue. Nous voyons là l’importance du positionnement idéologique. Dans le premier cas, le chômeur est improductif ; dans le deuxième, il produit. Il ne s’agit pas de la vérité contre l’erreur mais bien d’un postulat contre un autre, comme dirait effectivement Bernard Friot. Dire qu’un intermittent du spectacle produit la valeur économique entre deux cachets qui s’exprime par le biais du salaire socialisé, c’est un acte politique. À partir de tout ça, il devient donc évident qu’il faut dès à présent mener la bataille politique pour augmenter la part du salaire socialisé des intermittents en diminuant les conditions d’entrée dans ce régime. C’est-à-dire passer de 507 heures à 250 heures, pour aussitôt revendiquer les 125 heures pour enfin arriver à 0 heure par an dans l’emploi. Ce qui nous amènera de fait au « salaire à la qualification personnelle » pour tous les travailleurs, et donc à réaliser le désir des intermittents : avoir un réel statut de travailleurs de la culture à l’image par exemple du statut des fonctionnaires.
À quoi renverrait concrètement un tel statut de « travailleur de la culture » ?
Rémy Cardinale : Ce nouveau travailleur de la culture ne sera plus payé aux cachets ou aux contrats de missions, mais à la qualification personnelle. Il aura un salaire à vie avec une possibilité de monter en qualification sur trois ou quatre niveaux, allant de 1 700 euros net à 5 000 euros net par mois. L’embaucheur, lui, ne payera plus l’artiste, il cotisera à une caisse de salaire à hauteur de 60 % de sa valeur ajoutée. Un nouveau rapport s’établira ainsi entre l’organisateur et l’artiste. Un rapport plus sain, moins subordonné, qui libérera le travail. Les artistes ne seront plus forcément contraints à des normes de rentabilité qui nivellent toujours vers le bas la création artistique. Les directeurs artistiques des festivals, ou autres saisons, pourront enfin programmer des projets innovants soutenus par des artistes qui ne seront plus obligés pour être engagés à une communication plus ou moins vulgaire, et un vedettariat abrutissant orchestré par des médias répondant eux aussi à des normes de rentabilité… L’idée est de continuer la révolution anthropologique entamée par les communistes de l’après-guerre, qui ont attaché le salaire à la personne. Pour que les travailleurs soient payés non plus pour ce qu’ils font, mais pour ce qu’ils sont ! Concrètement, chaque résident français doit avoir à l’âge de la majorité une qualification personnelle qui s’exprime par un grade.
Cette « qualification » n’est pas un diplôme.
Rémy Cardinale : Non. Elle exprime la capacité à produire de la valeur économique et non de la valeur d’usage qui est, quant à elle, l’expression du diplôme. La qualification renvoie au travail dit « abstrait », le diplôme au travail dit « concret ». La classe sociale qui a la main sur le travail abstrait a automatiquement la main sur le travail concret. Par exemple, si c’est la famille Peugeot qui décide de ce qui vaut en matière de valeur économique dans les transports, il ne faut pas s’étonner du manque d’investissement dans les transports dits « doux ».
Ce grade sera un nouveau droit politique, un attribut de la personne qui ne pourra être enlevé. Le salarié ne pourra qu’avancer dans sa carrière en passant des épreuves de qualification de un à trois niveaux. Mais ce nouveau droit politique devra être lié à un autre droit, celui de la propriété d’usage des collectifs de travail afin d’avoir la maîtrise sur le travail dit concret. Seuls les salariés des lieux de travail pourront élire leur hiérarchie. En finir, par exemple, avec des directions de théâtres nommées par des ministères qui ne servent jamais les intérêts des salariés eux-mêmes. Décider nous-mêmes de ceux qui vont nous diriger, c’est avoir un droit de regard sur la production concrète. Un droit de regard sur la programmation des lieux culturels, un droit de regard sur sa mise en œuvre : qui va diriger l’orchestre par exemple, et le congédier s’il ne convient pas aux travailleurs de la culture ? Bref, être souverains sur nos lieux de production. Pour résumer, le nouveau salarié marchera sur deux jambes : celle de la maîtrise du travail abstrait et celle de la maîtrise du travail concret. Seule solution pour se tenir debout et en équilibre.
Avec la cessation des activités culturelles liée au Covid, on a vu fleurir des slogans tels que « Sauver la culture », « La culture en danger ». D’après vous, ils ne font que masquer davantage encore la réalité du travail. L’effet pervers est que même les musiciens concernés par la précarité finissent par intégrer l’idée qu’ils ont besoin de la solidarité interprofessionnelle. En fin de compte, n’est-ce pas l’idée même de la « musique classique », ou plus généralement celle d’un art « noble », qu’il faudrait défaire pour la faire entrer dans l’arène du politique ?
Rémy Cardinale : Comme vous le rappelez, le slogan même de « Culture en danger » nous enferme dans une idéologie de classe. Il nous amène fatalement sur une naturalisation de l’art et nous coupe de la production des travailleurs de la culture. C’est désolant de voir que nous le répétons comme des automates. Les actions que nous menons depuis les occupations des théâtres, avec des lectures de notre appel et les échanges que nous essayons de créer avec la militance syndicale et les artistes engagés, nous donnent de l’espoir. Quand nous arrivons à créer les conditions du dialogue sur le champ politique, le regard des artistes reprend de la vigueur. Tout à coup ils réalisent que tout est là pour changer notre condition. C’est cette bataille qu’il faut mener, mais il faut être beaucoup plus nombreux — la fameuse masse critique !
D’autre part il est plus qu’intéressant d’observer le mutisme des élites artistiques qui grenouillent en général dans des institutions comme celle des Victoires de la musique et qui fréquentent pour certaines l’oligarchie du pouvoir. Leur malaise est palpable car ils sentent bien qu’ils sont dorénavant dans une contradiction. Ils ne se sont jamais cachés d’être des sujets du pouvoir bourgeois. Ils en tirent un bénéfice. Même si certains galèrent un peu, ils parient en quelque sorte sur un éventuel retour sur investissement. Le mépris qu’ils ont toujours eu pour ceux qui s’engagent sur le champ idéologique et politique n’a d’égal que leur suffisance. Et voilà que les mesures prises par le gouvernement pour contrer le Covid-19 les obligent à l’inactivité forcée. C’est la crise pour eux aussi. Quelle ironie du sort ! Alors comment se dépêtrer d’une telle contradiction ? Se lancer sur le terrain de la politique ? Impossible ! Ils n’ont pas cette culture et croient naïvement que les « jours heureux » reviendront bientôt. La période post-crise verra (et on le voit déjà) le secteur musical se concentrer encore plus sur les stars ultras médiatisées. Les artistes des deuxième et troisième cercles connaîtront une sévère précarité, avec une baisse non négligeable de la valeur de leurs cachets, sans compter qu’un grand nombre d’entre eux seront exclus du régime de l’intermittence du spectacle. Le moment peut-être pour eux d’enfin réfléchir à un autre mode de production. En revanche, j’avoue être impatient de voir comment les stars et autres divas, vont réapparaître sur scène scandant sur le champ de ruines culturelles : « La culture ne meurt jamais ! »
Illustrations de vignette : Edward Avedisian
- L’exemple suivant est significatif : Mozart reçoit à cette époque une commande de plusieurs quatuors avec piano et cordes de la part de Hoffmeister, une maison d’édition de musique à Vienne. Il envoie son premier quatuor K 478 en sol mineur à l’éditeur qui résilie son contrat aussitôt, estimant l’œuvre trop difficile donc invendable pour son public. Cet exemple célèbre rappelle que sa nouvelle liberté est toute relative.↑
- L’assurance chômage au régime général de 1958 et les annexes 8 et 10 pour les techniciens et les artistes en 1967 contribuent à une véritable amélioration des conditions de travail pour les travailleurs du spectacle.↑
- En mai 2020, le violoncelliste Gautier Capuçon, dans un accès de générosité, annonce une grande tournée d’été, partout où il sera « invité ». La seule condition, précise-t-il, est la présence d’une prise électrique pour brancher son iPad (et, accessoirement, un cachet de plusieurs milliers d’euros par concert, selon la taille de la municipalité). Précisons toutefois que, sous la pression de la communauté musicale, le violoncelliste a finalement renoncé aux cachets. Il n’aura droit qu’à un reportage d’une heure sur la chaîne publique France 2, diffusé en janvier 2021.↑