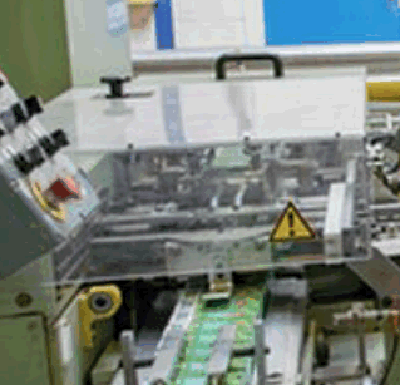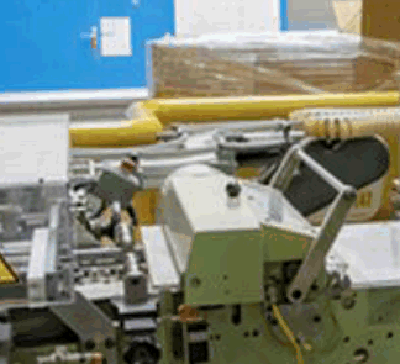Seminaire S03E03 - L’entreprise et le partage des pouvoirs

Réseau Salariat - Séminaire «Entreprise» - Octobre 2019 -juillet 2020
Rencontre Réseau Salariat du lundi 2 décembre 2019
Bourse du travail
Intervention d’Olivier Favereau et échanges avec les participants
(Ce compte rendu rédigé par Daniel Bachet a été relu, corrigé et modifié par Olivier Favereau, Benoît Borrits, Annie Phalipaud, Aurore Birba-Bachet, Gille Ringenbach et Jean- Michel Toulouse).
L’exposé d’Olivier Favereau a porté sur plusieurs thèmes concernant l’entreprise, les droits de propriété et l’organisation des pouvoirs sous la forme de la codétermination (partage des pouvoirs dans les organes de gouvernement de l’entreprise). La définition de l’entreprise et du travail ainsi que la place des différentes parties prenantes et constitutives de l’entreprise ont été longuement traitées (voir pour plus de détails et de précision le diaporama d’Olivier Favereau).
Olivier Favereau fait référence tout au long de son exposé au petit ouvrage fondamental de Jean-Philippe Robé L’entreprise et le droit (Que sais-je ? PUF, 1999). Dans cet ouvrage, l’auteur montrait que les actionnaires n’étaient pas propriétaires des entreprises dès lors que l’entreprise n’était pas définie en droit. L’entreprise n’est ni un objet ni une personne. On ne peut être propriétaire d’une entité non définie. Ce qui est défini, c’est la « société de capitaux », créée par les actionnaires fondateurs, qui va être le véhicule juridique de l’entité économique, bien réelle qu’est l’entreprise. Dans la perspective anglo-saxonne qui devient très puissante dans les années 1970 puis 1980, l’entreprise doit créer de la « valeur » in fine pour les actionnaires. La grande question de la gestion est donc d’aligner au mieux les incitations des manageurs sur les intérêts des actionnaires, par exemple les stock-options. Telle est la conception de la « shareholder value ». Le fondement de la financiarisation des quarante dernières années n’est autre que la priorité exclusive donnée au « droit de propriété ». Le problème est que Milton Friedman, le propagandiste influent de ce modèle actionnarial, a « oublié » la société entre les actionnaires et le reste de l’entreprise. En oubliant cette entité juridique « écran », l’entreprise n’est plus qu’un quasi-actif financier, dont les actionnaires seraient propriétaires.
Olivier Favereau montre que fondamentalement, la théorie de Milton Friedman est fausse. Pour construire une autre approche de l’entreprise (pluraliste et sous forme de codétermination) il faut apporter une force de frappe pluridisciplinaire et montrer l’ampleur des conséquences d’une conception alternative en économie, finance, gestion, sociologie, philosophie politique, anthropologie. Ces dernières années, le système de gouvernement partagé, dit de « codétermination », est revenu sur le devant de la scène. Codétermination signifie détermination en commun, de manière collective. Il s’agit de l’ensemble des pratiques qui tentent de donner un rôle significatif aux salariés dans le gouvernement (ou la gouvernance) de leur entreprise. En attribuant des sièges aux représentants du personnel dans les instances de supervision, il leur est proposé d’accéder aux informations et aux délibérations sur les questions relatives à la stratégie de l’entreprise.
Le terme de codétermination souligne le caractère coopératif de ce modèle de participation des salariés, qui doit permettre, au moins sur le principe, d’équilibrer les intérêts des différentes parties constitutives concernées.
C’est en Allemagne, en Suède ou au Danemark que ces pratiques ont été progressivement mises en place et ont connu une certaine audience après la Seconde Guerre mondiale jusqu’à aujourd’hui.
C’est donc la codétermination qui devrait être le gouvernement « normal » de l’entreprise et non la théorie de l’agence fondée sur le seul droit de propriété.
Ni publique, ni privée, car non appropriable, l’entreprise reste un impensé du politique. En revanche, selon Olivier Favereau, le langage adéquat est celui du « pouvoir ». La bonne question devient celle-ci : si les actionnaires ne sont plus considérés comme propriétaires de l’entreprise, pourquoi devraient-ils garder le monopole de l’élection des membres des conseils d’administration ? C’est la question des administrateurs salariés et c’est cette formule plus équilibrée qui s’est mise en place également à bas bruit dans plus de la moitié des pays européens. La codétermination comme norme de gouvernement d’entreprise a été discutée tout au long des années 1970 au niveau européen. Le néolibéralisme a brutalement interrompu ce processus de démocratisation. C’est le moment de la reprendre selon Olivier Favereau.
Questions et réponses
Une première question a porté sur la possibilité qui est offerte aux propriétaires de vendre leur entreprise comme une marchandise et une seconde sur le « revenu de base » ou revenu universel. Une troisième question a été soulevée concernant la possibilité de reprendre dans le monde des entreprises l’idée coopérative : un individu = une voix.
Olivier Favereau rappelle que si l’on rachète de nombreuses actions, on peut finir par « contrôler la société ». Mais « contrôler » désigne un état de fait, qui ne peut se prévaloir d’aucune valeur normative, alors que Friedman, en parlant de « propriété » prétendait donner une légitimité absolue à la liberté décisionnelle de l’actionnaire.
Quant au revenu de base, il n’est pas directement lié au fonctionnement de l’entreprise et ne part pas de l’hypothèse selon laquelle les salariés « sont chez eux » dans l’entreprise. Le concept de revenu de base est extérieur au monde de l’entreprise et à la production des richesses et ne concerne finalement que le problème de la redistribution (déconnectée de la production).
Concernant l’idée coopérative, Olivier Favereau rappelle qu’elle concerne par définition l’économie sociale et solidaire alors qu’il a voulu se concentrer sur la société standard. Même pour celle-ci, il poursuit en indiquant qu’il n’existe pas de théorie économique ou juridique de la codétermination. Cependant, la Cour de cassation n’accepte pas que « l’intérêt de la société » soit réductible à ceux des associés (détenteurs de capitaux). D’où le projet de s’engouffrer dans cette brèche pour faire valoir la conception de « l’entreprise pluraliste » et codéterminée.
Une seconde question est posée par Jean-Michel Toulouse qui souhaite aborder la distinction présente chez Marx entre « force de travail » (qui se vend et relève donc du travail abstrait) et « travail concret ». Jean-Michel Toulouse doute que la codétermination ait véritablement changé et rééquilibré les rapports de force entre travail et capital (voir en particulier les régressions que constituent les lois Hartz et les mini-jobs en Allemagne). Les réformes Hartz d’inspiration libérale sont des réformes du marché du travail qui ont eu lieu en Allemagne, entre 2003 et 2005 et qui ont précarisé le travail et baissé son coût. J-M Toulouse définit le capitalisme comme un système prédateur et productiviste auquel la Loi PACTE n’apportera aucun correctif positif.
Olivier Favereau considère qu’on ne peut pas juger équitablement des mérites de la codétermination, telle qu’elle est déjà pratiquée. En effet depuis les années 1980, la philosophie de de la construction européenne est devenue fondamentalement néo-libérale. Elle fonctionne donc de fait dans un environnement politique, économique et culturel qui impose des critères d’évaluation qui lui sont opposés (puisqu’ils sont ceux de l’entreprise financiarisée). La bonne question à poser est plutôt : quels devraient être les critères de gestion d’une entreprise codéterminée ?
Olivier Favereau rappelle l’ouvrage de Michel Albert (1991) dans lequel celui-ci indiquait que le « capitalisme rhénan » était supérieur au capitalisme anglosaxon mais que ce dernier allait l’emporter, car il était plus « attractif ». La mobilité des travailleurs qualifiés et leur liberté, puis les traders qui gagnent des sommes importantes apparaissent comme des modèles enviables. La montée de l’individualisme et l’attrait multiforme de la finance vont créer un milieu très réceptif à l’émergence d’une vison « déformée » de l’entreprise, où l’action est assimilée à un droit de propriété. Dans les départements de finance, de gestion, et d’économie, en Allemagne, on n’enseigne pas la codétermination (et on ne réfléchit pas sur les critères de décision qu’elle devrait impliquer) mais la « share-holder value » !
Par ailleurs, O. Favereau souligne que la théorie économique, et, à vrai dire aussi, la pratique politique et syndicale, ne se sont pas intéressés au « contenu concret » du travail. Au minimum, on pourrait distinguer trois dimensions du travail « concret » :
- La dimension « production » (il s’agit de fabriquer des choses, qui ont toujours une composante physique et qui transforment la nature).
- La dimension « coopération » (il s’agit de travailler avec d’autres).
- La dimension « innovation » (il s’agit de résoudre des problèmes imprévus).
Selon O. Favereau, avec cette simple grille, on peut déjà faire apparaître les conséquences dommageables de la financiarisation des 40 dernières années (les 2 dernières dimensions réduites à la conformité aux incitations d’un management par objectifs).
Une question est posée concernant la collaboration capital/travail. Une participante aux échanges considère qu’il faut arrêter les demi-mesures et ne plus faire de compromis avec le capital.
Olivier Favereau indique que, selon lui, le traitement sur un pied d’égalité des salariés et des actionnaires changerait radicalement la finalité de l’organisation productive, en ramenant l’argent à son rôle instrumental. Si c’est une demimesure, elle suscite en tous cas l’opposition farouche du patronat français. Ce qui est une demi-mesure, ce serait de promouvoir « l’actionnariat salarié », surtout avec l’argument fallacieux (que l’on retrouve quelque fois chez certains militants) selon lequel cela ferait des salariés les (co)propriétaires de l’entreprise. Toute autre est la logique de la codétermination : les salariés doivent partager le pouvoir de gouvernance, non comme actionnaires mais comme salariés.
Benoît Borrits souligne qu’au XXe siècle, une importante remise en cause de la propriété privée a commencé à se développer, en particulier à travers le droit du travail et la cotisation sociale. Il note que dans les années 1970, le taux de profit a largement reculé, ce qui aurait pu déboucher sur une sortie du capitalisme. Cela n’a pas été le cas, pour des raisons essentiellement politiques, et c’est le néolibéralisme qui s’est mis en place en remettant en cause ces avancées sociales. Quelles sont les chances de voir éclore la « société pluraliste » présentée par Olivier Favereau ? On remarquera tout d’abord que dans tous les cas cités d’Europe du nord et de l’est, la voix des propriétaires est toujours majoritaire dans les conseils d’administration et conseils de surveillance des entreprises. Il nous faut donc aller plus loin. En Suède, dans les années 1970, le syndicat LO a adopté le plan Meidner qui devait permettre aux salariés d’être progressivement majoritaires dans les entreprises par l’entremise d’un fonds salarial. Ce projet a été rejeté par le parti social-démocrate, pourtant organiquement lié au syndicat. Dans les faits, ce plan aurait pu marcher s’il avait été adopté très tôt, par exemple dans les années 1920-1930 : les actionnaires auraient pu accepter ce cadre car les perspectives de croissance étaient là et leur garantissaient un bon retour sur investissement. Ce n’était plus le cas dans les années 1970. Voilà pourquoi, ils pensent que les chances de voir apparaître la « société pluraliste » sont minces : dans un contexte de faible croissance, les actionnaires exigent de très forts dividendes qui ne sont guère compatibles avec la prise en compte d’autres critères. Benoît Borrits pense donc que la question qui doit aujourd’hui être posée est l’abolition de la propriété lucrative pour laisser la place à une propriété d’usage sous la forme d’une entreprise organisée et gérée par les travailleurs.
Olivier Favereau partage cette critique du droit de propriété, puisque tout le sens des travaux menés aux Bernardins consiste à sortir l’entreprise du langage de la propriété pour dire que le langage approprié pour penser l’entreprise est celui du pouvoir. Qui est propriétaire des « moyens de production » dans le capitalisme ?
Non pas les personnes physiques des capitalistes et des actionnaires, mais les personnes morales des sociétés. Il faut donc s’attaquer aux pouvoirs de gouvernance de ces « personnes ». Tel est le projet politique de la codétermination. En outre, Olivier Favereau rappelle que le concept de personne morale a été historiquement forgé par et pour l’Etat. Jusqu’à la loi de libéralisation de la création des sociétés anonymes de 1867, le secteur privé ne pouvait en bénéficier que si l’activité de la société poursuivait un but d’intérêt général. Cela devrait nous inspirer pour refonder l’entreprise pluraliste du XXIème siècle.
Gilles Ringenbach indique qu’il est très dubitatif sur le caractère « de plus grande ouverture » aux salariés et à leurs représentants du modèle rhénan dès lors que ce dernier s’est de plus en plus aligné sur les normes sociales et financières du modèle anglo-saxon. Concernant l’approche du travail, Gilles Ringenbach considère que les travaux de Christophe Dejours (entrepris dès les années 1970) et d’Yves Clot ont su redonner toute son importance au travail concret et à la richesse de ses multiples déterminations. Il serait souhaitable, selon lui, de prendre en compte leur apport majeur pour refonder l’entreprise et le travail.
Olivier Favereau a le même point de vue sur l’apport de C. Dejours et d’Y. Clot, précieux pour compléter sur le plan de la subjectivité les dimensions objectives qu’il a distinguées dans le contenu du « travail concret ».
Quant au modèle rhénan, par rapport à la mondialisation, il souhaite faire part de l’expérience de Jean-Louis Beffa, telle qu’il l’avait racontée dans un séminaire aux Bernardins. Membre du conseil de surveillance de Siemens, il avait été impressionné par le fait d’avoir assisté à une concertation entre administrateurs salariés et représentants des actionnaires pour décider des activités qui pouvaient être délocalisées et de celles qui devaient impérativement demeurer sur le territoire national (allemand). Préfèrerait-on que ces décisions soient prises uniquement par les actionnaires ?
Annie Phalipaud s’interroge sur le véritable pouvoir des salariés concernant le « contenu » de leur travail. Quelle connexion peut-on établir avec les pouvoirs stratégiques dans l’entreprise sachant que le pouvoir du salarié ne peut pas se réduire à intervenir simplement sur l’espace local de sa situation de travail ?
Olivier Favereau précise qu’il n’a parlé jusqu’à présent que du volet « stratégique » de la codétermination : la participation des salariés aux conseils d’administration ou de surveillance. Mais il y a l’autre volet, portant sur l’organisation du travail, et qui est du ressort (en Allemagne) du « betriebsrat », ou conseil d’établissement. Celui-ci est à la base de l’entreprise, quand le conseil d’administration ou de surveillance est en en haut. C’est l’ensemble des deux dispositifs qui fait la cohérence de la codétermination.
Bernard Friot pose à Olivier Favereau la question de la légitimité du management et des actionnaires. Ces derniers sont-ils vraiment indispensables dans un cadre économique, politique et social renouvelé où la propriété lucrative aura été abolie ? Est-ce que ce ne sont pas les travailleurs et eux seuls qui produisent la valeur ? Pourquoi conserver la notion de « société », entité avec laquelle les détenteurs de capitaux prennent le pouvoir et le conservent ?
Olivier Favereau ne partage ni le point de vue de l’économie néo-classique, pour qui le profit est la productivité marginale du capital, ni celui de Marx pour qui le profit vient du surplus produit par le seul travail. Il rejoint la thèse à la fois Proudhonienne et post-keynésienne, selon laquelle au-delà de la rémunération légitime du capital et du travail, il y a un « reste » ou un « excédent », qui est au fond le pur produit du collectif qu’est l’entreprise, rendu possible par l’interaction du travail et du capital. On en a d’ailleurs une trace dans les systèmes comptables actuels avec la marge brute d’autofinancement.
Quant à la notion de « société », le problème est qu’il n’y a pas d’entreprise sans le véhicule juridique de la personne morale de la société. Par ailleurs, toute entreprise a besoin du véhicule juridique qu’est la « société ». C’est elle qui embauche, investit, rémunère, etc. Chacun peut imaginer un substitut – mais il en faut un. En attendant, on peut agir tout de suite en changeant les règles de gouvernance de la société.